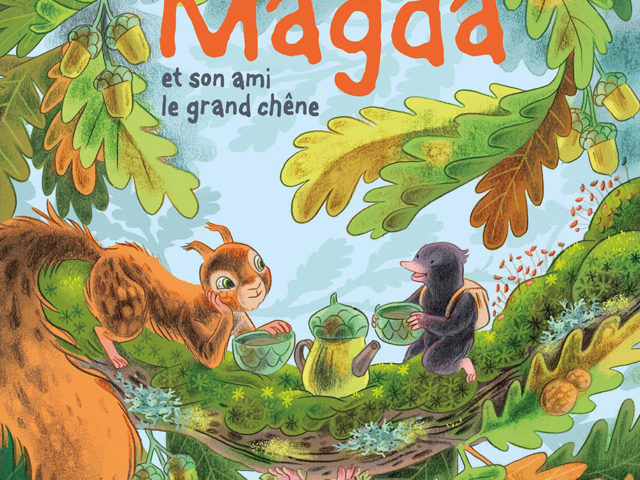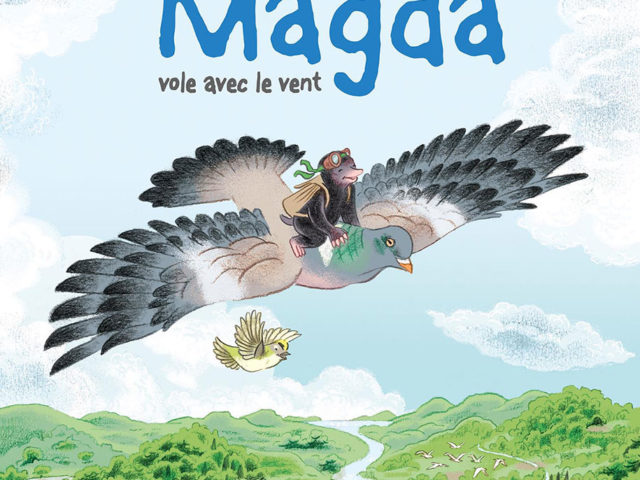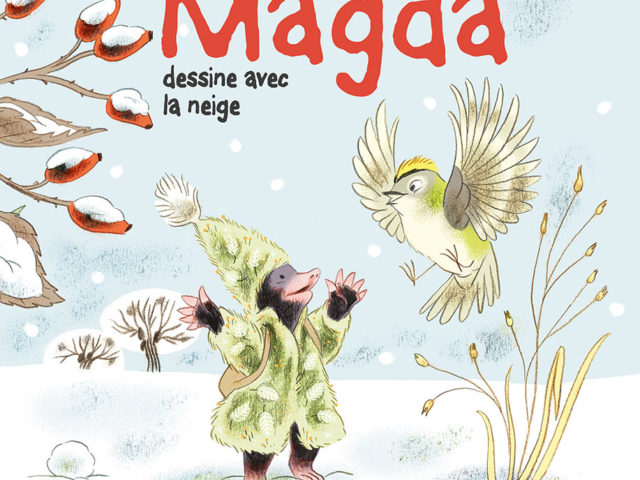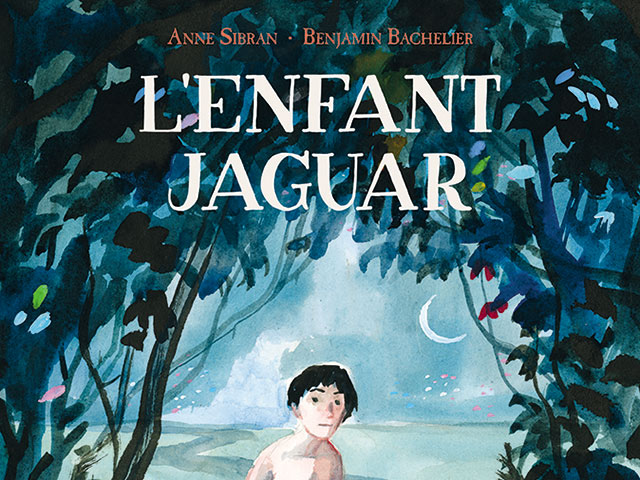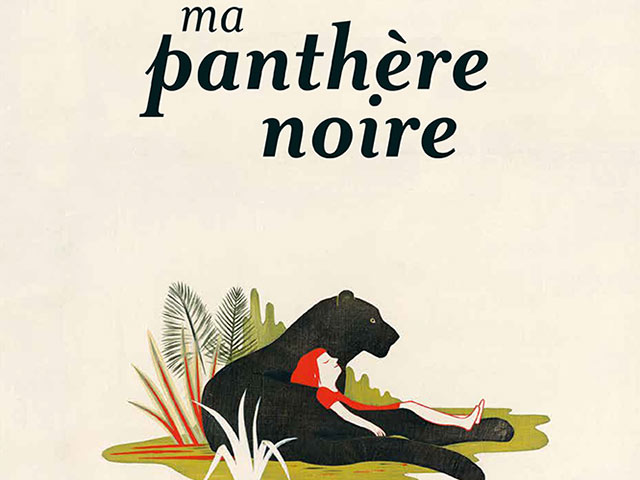ThȨme
C’est un journal d’inadvertances, de petits miracles, de gouffres et de splendeurs, où tout est prétexte à l’attention…
Un journal d’écrivain aussi.
Extrait
« Passé minuit, la rue Myrha perd son regard, les derniers rideaux s’abaissent des bistrots d’Algérie dont chaque table fait un village -ici on dit un bled- où les hommes se retrouvent pour jouer aux cartes comme ils feraient là-bas. Sauf qu’ici quand ils se lèvent pour partir personne ne les attend. Il n’y a pas la soupe chaude, la femme dans le lit avec le plus jeune des enfants. Il n’y a que le visage fermé d’un autre homme avec ces mots qu’ils ne vont pas se dire, ces conditions d’exil qu’ils gardent comme un secret.
Ils étaient chacun à leur chaise, ou dehors accroupis sur le trottoir, à fumer longuement. Mais ceux-là maintenant sont montés dormir. L’épicier ferme aussi, les derniers restaurants, et quelque chose perce déjà dans la rue, que couvrait tout à l’heure le brouhaha débonnaire des papotages entre voisins. Ceux qui restent n’ont nulle part où aller. Certains s’affolent, il leur faut plus d’alcool, plus de drogue, une femme à tenter. D’autres laissent enfin éclater la colère qui couvait. Et les voilà qui s’empoignent, s’accrochent, se tirent par les habits. Ils ne se font pas vraiment mal dans ces combats au ralenti, ils s’entraînent à tomber. Pour se relever l’un sans l’autre, cracher un mot, partir se cacher. D’ailleurs personne ne les sépare, je l’ai dit, la rue a perdu son regard. À cette heure les gens sont seuls, il n’y a plus de compassion. Plus ces discutions À tue-tête en Wolof, en Malien dans les cabines téléphoniques de la rue Cavé, où un homme accroupi essaye maintenant de dormir. Le coin de mur est devenu une pissotière depuis que l’ampoule du réverbère a grillé. Quelques prostituées attendent encore sans trop y croire. Celle qui chantait tout à l’heure s’adosse au mur à s’y confondre.
Quelques jeunes, toujours les mêmes au coin de la rue Léon. Le square reste toute la nuit grand ouvert, mais je sais qu’à présent, il serait imprudent d’aller le traverser. Les dernières familles sorties dîner rentrent en pressant le pas.
Voilà , il n’y a plus personne. Le fou de la mosquée, assis sous un porche, a toujours ce même sourire, entre cruauté fine et joie d’enfant. Il le donne à tous, indifféremment -ceux que la police embarque, qui lui jettent une pièce, le prient de dégager. Il ne parle jamais. Mais il est toujours là quand il se passe quelque chose, accroupi par terre, un peu sur le côté. La nuit des affrontements avec la police, je voyais danser sur son sourire les flammes des voitures incendiées. Puis il s’est volatilisé un instant avant le passage des CRS. Et maintenant il est le dernier regard de la rue sous la lumière orange d’un soleil de pleine nuit où les caniveaux débordent d’une eau claire, généreuse. Je sais depuis peu qu’un vieux retraité blanc et raciste s’est procuré la clef des agents de la voirie, et qu’il passe son temps à remplir les caniveaux pour « assainir » le quartier.
C’est l’heure aussi où passent lentement quelques voitures agonisantes aux moteurs toussotant, aux pneus crevés, déplacées discrètement sans le regard de la police, les autorisations de circuler. Puis d’immenses bulldozers viendront faire vibrer les verres des étagères en prenant lentement possession des chantiers. Ce qu’il reste à démolir.
Plus tard encore, presque au matin, je serai réveillée par la voix d’un homme, déchirante, qui criera longuement en remontant la rue, avec cet accent qui me retourne le ventre : » je suis ici chez moi, je suis ici chez moi ! »